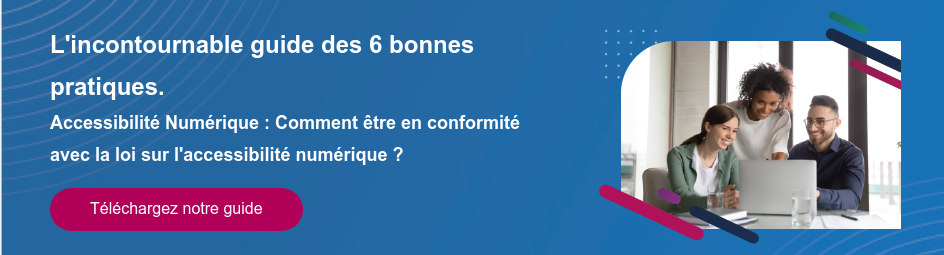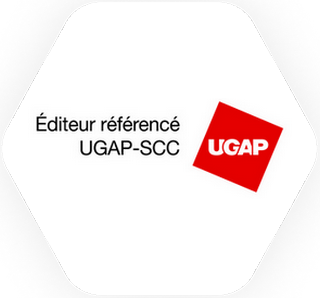Découvrez l’importance de la transposition de l’EAA, ses enjeux en matière d’accessibilité et les failles potentielles. Apprenez-en plus dans notre article.
L’EAA figure parmi les règlements européens à transposer dans le droit national – loi DADUE du 9 mars 2023. Cette directive constitue un jalon essentiel, d’abord pour encourager les initiatives de l’accessibilité. Ensuite, elle veut assurer le respect des normes d’accessibilité moyennant un durcissement des sanctions (en cas de non-conformité). Néanmoins, quelques interrogations subsistent dans les mesures de cette transposition. Nous vous détaillons tout dans cet article.
Critères et niveau de conformité de l’acte européen d’accessibilité
D’ici 2025, « tous les sites et plates-formes de commerce électronique doivent être accessibles pour les nouveaux services ». 2030, pour l’existant.
Le problème : un site qualifié « accessible » aujourd’hui doit être 100 % conforme au RGAA, mais très peu de sites respectent cette exigence. Il est fort probable que la majorité des entreprises concernées voient dans la mise en accessibilité un processus trop complexe. Par conséquent, elles préfèrent payer l’amende plutôt que de s’engager à rendre leurs services accessibles.
En outre, même si la loi instaurait un seuil minimal de conformité, tous les critères du RGAA ont la même valeur dans le calcul du taux aujourd’hui. Autrement dit, un site avec un score de 90 % pourrait ne pas être accessible au clavier.
Deux solutions :
- Pour pouvoir valider un site comme « accessible », miser sur certains critères spécifiques dans le système d’évaluation. Par exemple, la navigation au clavier sans obstacles avec un focus clairement visible en permanence. Ou la retranscription de toutes les informations présentes visuellement au lecteur d’écran (images, libellées de boutons ou de liens…).
Si le site ne répond pas à ces critères, il pourrait être automatiquement considéré comme non conforme.
- Il est également possible d’optimiser le calcul du taux en considérant plus sérieusement les critères les plus significatifs pour les utilisateurs. Comme la possibilité de zoomer jusqu’à 200 % sans perte d’informations.
Des précisions attendues concernant les documents bureautiques
En dehors des plates-formes numériques (sites web, applications…), on attend aussi des précisions sur la documentation bureautique dans le cadre de la transposition. Plus spécifiquement, les communications électroniques et les documents courants. Ces supports d’information sont transmis la plupart du temps sous forme de fichiers PDF.
Factures, fiches de paie, relevés bancaires, présentations commerciales, notices d’information… Tous ces documents PDF sont omniprésents dans nos utilisations quotidiennes. Néanmoins, un grand nombre d’individus peinent toujours à accéder et à consulter ces fichiers de manière autonome.
Le texte de transposition préconise l’utilisation de documents accessibles sans fournir de directives claires sur les formats à adopter pour assurer cette accessibilité.
En l’état actuel de la réglementation, nous recommandons la norme PDF/UA comme support. Celle-ci répond à divers critères de conformité et constitue une référence internationale soutenue par la PDF Association. Des outils existent pour valider la conformité et cette norme demeure jusqu’à présent la plus efficace pour garantir une qualité de service optimale.
Par ailleurs, bien que le format PDF/UA présente certaines limites, notamment en termes de contraste et de bonnes pratiques typographiques, des alternatives existent pour générer des versions HTML accessibles à partir d’un document PDF balisé.
Défaut de coordination des organismes de contrôle
Jusqu’à présent, les cas de non-conformité au référentiel RGAA n’ont pas encore fait l’objet de sanctions signalées.
La transposition a défini des organismes de contrôle et leur fonction pour assurer le respect des obligations d’accessibilité. Par exemple, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour le secteur du commerce électronique ou encore la Banque de France, responsable des systèmes d’authentification et de signature électronique.
Bien que ces entités soient hautement compétentes dans leurs domaines, elles ne maîtrisent pas forcément des attentes en accessibilité numérique.
La mise en œuvre de l’accessibilité numérique va bien au-delà de la simple compréhension des défis existants. Il est crucial de saisir les référentiels ainsi que les aspects techniques, graphiques et éditoriaux applicables. Un délai d’adaptation est nécessaire avant d’établir ces contrôles et d’appliquer des sanctions éventuelles.
Le recours à des agences et des spécialistes de l’accessibilité sera indispensable pour faciliter la mise en place et le maintien de l’accessibilité.
Rappelons que la directive européenne vise avant tout à assurer un niveau d’accessibilité uniforme à travers l’Europe. Comme le marché s’élargit et que la demande progresse, la concurrence s’intensifie inévitablement en conséquence. Et espérons-le, cela va atteindre des niveaux de qualité encore plus élevés et rehausser les standards d’accessibilité.
Remarque : la plupart des formations initiales numériques (développement, projet et conception) ne parlent pas beaucoup des enjeux liés à l’accessibilité. Même si elles peuvent apprendre à réaliser des tests d’accessibilité via un référentiel, il est crucial d’évaluer la criticité et la priorisation des non-conformités par rapport à leur impact utilisateur. Cela facilitera la mise en place d’une stratégie de mise en conformité et une application des bonnes pratiques de manière plus efficace.
Quelle est la prochaine étape ? Un questionnement sur l’avenir.
Chez Ipedis, nous cherchons toujours à mettre l’utilisateur au cœur de nos projets. Nous croyons fermement que les réflexions présentées ici méritent d’être approfondies.
Les amendements législatifs attendus joueront un rôle décisif pour assurer la cohérence du cadre réglementaire et des sanctions liées à l’accessibilité, évitant ainsi la non-conformité avec les lois en vigueur. Certaines organisations ont déjà adopté une approche plus inclusive en intégrant activement les besoins des utilisateurs dans leur fonctionnement. Alors que d’autres tardent à le faire.
Le durcissement des lois en Europe devrait inciter les entités publiques et privées à agir. Nous espérons sincèrement que cette démarche sensibilisera davantage les gens à l’importance du handicap et de la nécessité de l’accessibilité numérique au sein de notre société.